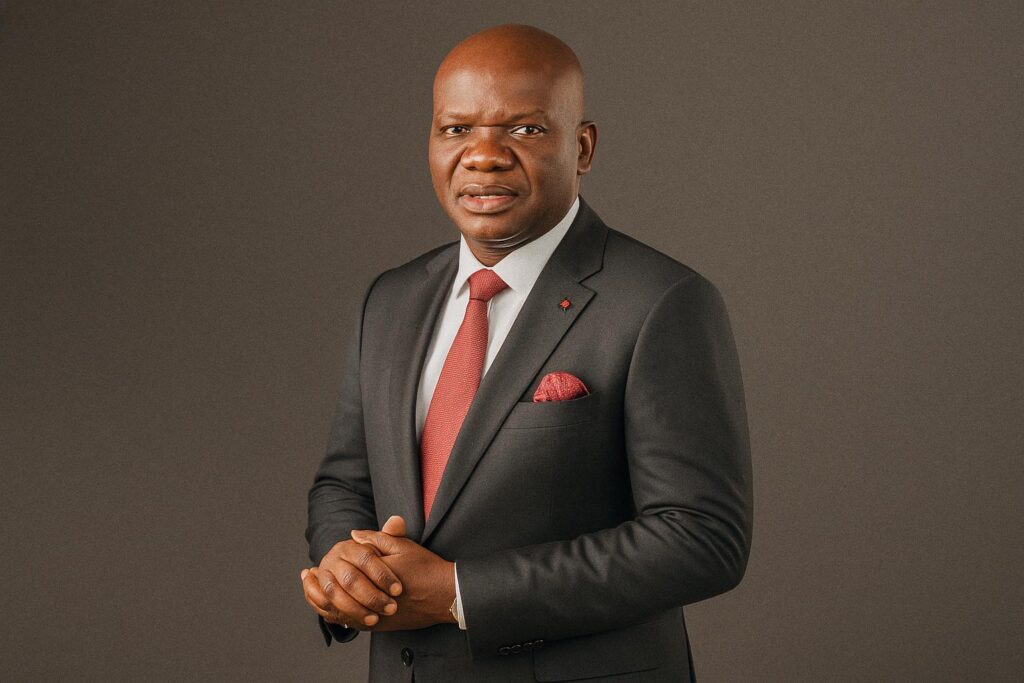De la victoire électorale à l’ingénierie institutionnelle
Il n’aura fallu qu’un mois entre la proclamation des résultats du 12 avril 2025 et la décision de conférer un statut juridique pérenne au Rassemblement des bâtisseurs (RDB). Fort des 94,85 % de voix ayant consacré sa légitimité, Brice Clotaire Oligui Nguema s’inscrit dans une logique de consolidation rapide des instruments de pouvoir. Créée le 12 mars pour fédérer 84 partis, 4 200 associations et 22 000 adhérents autour de sa candidature, la plateforme devient aujourd’hui parti politique avec l’ambition affichée de servir de « colonne vertébrale » à la Deuxième République qu’il entend instaurer.
Un calendrier resserré sur fond de législatives et de réforme
Initialement prévue le 19 avril, l’assemblée constitutive du nouveau parti a été décalée afin de permettre une vaste consultation provinciale, signe d’une volonté de légitimation territoriale. Car l’échéance la plus pressante demeure les législatives fixées de manière non officielle à août 2025, scrutin qui déterminera la capacité du chef de l’État à disposer d’une majorité stable. Dans les états-majors, l’objectif est limpide : transformer l’« élan présidentiel » en majorité parlementaire homogène, condition sine qua non pour guider la transition jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Encadrement du pluralisme : entre discipline et controverse
Le 17 juin, l’Assemblée nationale de transition a adopté en première lecture un projet de loi imposant un seuil de 12 000 adhérents dûment identifiés, une transparence financière renforcée et la conformité aux principes constitutionnels. Inspiré du Dialogue national inclusif, le texte vise à prévenir les « effets pervers d’une offre politique atomisée », argumente un membre du bureau de l’Assemblée. Si l’exécutif défend un assainissement nécessaire, l’opposition dénonce un couloir législatif trop étroit, soupçonnant un mécanisme de verrouillage qui handicape les petites formations dépourvues de réseaux ou de ressources substantielles.
Les critiques : échos d’un passé omniprésent
Les réminiscences de l’hégémonie du Parti démocratique gabonais, tombé avec le régime Bongo, alimentent les réticences. « C’est le retour d’un appareil unique sous un nom neuf », s’alarme l’ex-syndicaliste et opposant Jean-Rémy Yama, pour qui la réforme ravive le spectre d’une domination sans partage. Le député de transition Jean Valentin Léyama réclame, quant à lui, une lecture « froide et mesurée » du texte au Sénat, afin d’éviter toute suspicion de musèlement. Pour l’entourage du président, ces critiques ignorent la nécessité de bâtir des forces politiques capables de porter des projets nationaux cohérents.
Un Sénat arbitre entre rationalisation et libertés publiques
La seconde lecture du projet de loi par le Sénat s’annonce déterminante. Sa marge de manœuvre réside dans la possibilité d’édulcorer certains articles tout en préservant l’esprit de rationalisation voulu par le dialogue national. Plusieurs sénateurs, soucieux de préserver la réputation du Gabon auprès des partenaires internationaux, plaident pour des garde-fous explicites en matière de droits de l’opposition. L’exécutif assure de son côté qu’« aucune disposition n’interdit la concurrence, pourvu qu’elle soit structurée et responsable », selon une source au ministère de l’Intérieur.
Dimension régionale : un laboratoire pour l’Afrique centrale ?
À Libreville, plusieurs diplomates voient dans cette réforme un cas d’école pour une sous-région coutumière de systèmes partisans foisonnants mais peu structurés. L’expérience congolaise, où les autorités de Brazzaville ont longtemps cherché à rationaliser le champ politique, est souvent citée en exemple de stabilisation progressive. Dans cette perspective, le Gabon cherche à conjuguer pluralisme et efficacité gouvernante, tout en évitant la fragilité que procure une mosaïque de micro-partis. Un ambassadeur africain estime que « si la greffe prend, Libreville pourrait offrir un modèle de discipline démocratique adapté aux réalités centre-africaines ».
Vers une Deuxième République sous haute surveillance
À court terme, le lancement du RDB comme parti à vocation dominante consolide la base politique du président. À moyen terme, la crédibilité de la réforme se mesurera à la qualité du débat législatif, à la transparence des financements et à l’équité des législatives anticipées. Toute suspicion d’autoritarisme pourrait obscurcir les relations avec les partenaires multilatéraux, soucieux de stabilité mais attentifs aux signaux démocratiques. À l’inverse, un parlement pluraliste, même resserré, pourrait accélérer l’agenda des réformes économiques et sécuritaires, dans un contexte régional où la gouvernance inclusive devient un critère incontournable de coopération.
Au-delà de l’arithmétique des sièges, l’épreuve du temps
Les prochains mois diront si la machine politique en gestation se montrera capable d’agréger sans étouffer, de discipliner sans exclure. L’histoire récente du Gabon rappelle que l’adhésion populaire se gagne moins par la mécanique partisane que par la capacité des institutions à délivrer des politiques publiques tangibles. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la transformation du RDB n’est qu’une étape parmi d’autres ; la pérennité de sa Deuxième République se jouera dans la capacité à maintenir, dans la durée, l’équilibre délicat entre efficacité décisionnelle et pluralisme réel.