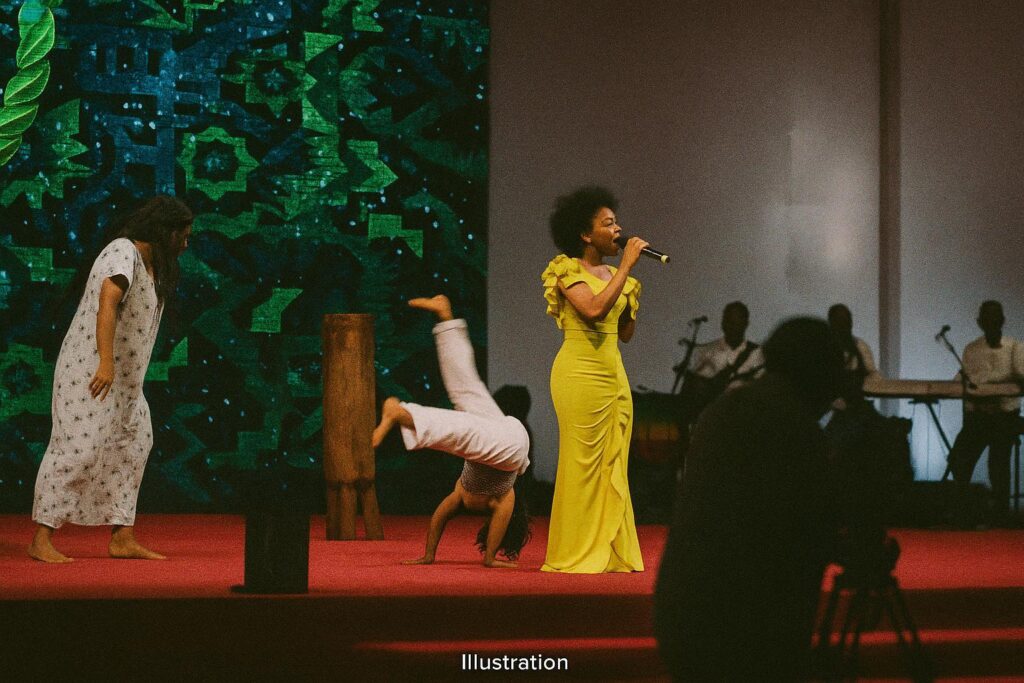Brazzaville au rythme du Fespam
Dès les premières notes résonnant sous la canopée humide de la capitale congolaise, le Festival panafricain de musique s’est imposé comme la colonne vertébrale culturelle du mois de juillet. Pour cette douzième édition, le Palais des congrès de Brazzaville a rassemblé un public composite – diplomates, investisseurs, mélomanes – venu mesurer combien la créativité africaine peut servir de levier économique. Dans cet amphithéâtre devenu caisse de résonance d’une Afrique plurielle, la présence du président Denis Sassou Nguesso et de nombreuses délégations étrangères a donné à l’événement une dimension protocolaire et stratégique qui dépasse la simple célébration artistique.
Un festival sous l’œil bienveillant des institutions
Créé en 1995 puis placé sous l’égide de l’Union africaine, le Fespam n’est plus seulement une vitrine culturelle ; il devient, édition après édition, un forum diplomatique informel où convergent intérêts culturels et ambitions économiques. L’engagement de l’exécutif congolais dans l’organisation logistique, la sécurisation des lieux et l’accueil des délégations témoigne d’une volonté politique affirmée : faire de la culture un pilier de la stratégie de développement national. Les annonces budgétaires dédiées aux industries créatives, relayées par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, illustrent cette orientation qui associe soft power et diversification de l’économie.
Le numérique, nouveau terrain de jeu créatif
Le thème retenu cette année – « Musique et enjeux économiques en Afrique à l’ère du numérique » – résonne avec acuité dans un contexte où le streaming a redistribué les cartes de la monétisation artistique. Les tables rondes ont insisté sur la sécurisation des droits d’auteur, la création de plateformes panafricaines de diffusion et l’attrait de nouveaux investisseurs. Des représentants de start-up locales, appuyés par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, ont présenté des solutions destinées à élargir l’accès des artistes aux marchés extérieurs, atténuant ainsi la dépendance aux majors étrangères.
Jeunesse congolaise, moteur de la scène panafricaine
Figure montante du slam, Mariusca Moukengue – alias Black Panthère – a électrisé les gradins en livrant un poème scénique où se mêlent colère contenue et tendresse patriotique. Dans un souffle quasi incantatoire, elle a rappelé que « la scène est ce lieu où les rêves deviennent contagieux », exhortant ses pairs à saisir les opportunités offertes par le numérique pour bâtir des carrières pérennes. Le danseur chorégraphe Gervais Tomadiatunga lui a emboîté le pas avec une fresque chorégraphique baptisée « L’année de la jeunesse », espace de dialogue entre hip-hop urbain, rythmes Kongo et gestuelle contemporaine. Le duo a donné chair au discours gouvernemental sur l’emploi culturel, soulignant l’ambition d’une génération désormais décidée à passer du statut de soutien au statut de pilier économique.
Rumba et slam, dialogue des héritages
Icône récemment inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, la rumba congolaise s’est faite ici partenaire de scène du spoken-word. L’alliance de la guitare séculaire et du verbe ciselé raconte une histoire : celle d’un pays qui assume la profonde stratification de ses identités culturelles. Cette hybridation porteuse conforte la stratégie mise en avant par le ministère de la Culture : préserver la tradition tout en stimulant l’innovation, condition nécessaire pour conquérir de nouveaux marchés sans perdre son âme.
Les enjeux économiques de la musique en Afrique centrale
Selon les chiffres présentés par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, l’industrie musicale du continent pourrait atteindre dix milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2030 si la structuration des filières se confirme. Le Congo-Brazzaville a bien compris cette perspective : amélioration de la gouvernance collective des droits, incitations fiscales pour les entreprises culturelles et partenariats public-privé sont désormais inscrits à l’agenda. Les diplomates présents à Brazzaville y voient un terrain propice à la coopération Sud-Sud, notamment avec des pays comme le Kenya ou le Ghana déjà avancés sur le modèle du hub numérique.
Le soft power congolais en action
En magnifiant les vingt-deux ans de la rumba urbaine et en invitant des têtes d’affiche venues de Kinshasa, d’Abidjan et de Lagos, le Congo-Brazzaville projette une image de stabilité et d’ouverture. Cette diplomatie culturelle séduit, comme en témoigne la multiplication des conventions signées en marge du festival avec des instituts étrangers. Pour les chancelleries, l’événement apparaît comme un baromètre fiable de l’environnement des affaires : l’affluence, la sécurité et la qualité des infrastructures sont autant d’indicateurs observés à la loupe.
Perspectives pour la diplomatie culturelle congolaise
Au terme d’une semaine de concerts et de colloques, le Fespam 2023 a démontré qu’il n’était pas seulement un point d’orgue artistique, mais un laboratoire d’idées au service d’une politique de rayonnement régional. Les engagements pris pour renforcer l’accès des jeunes à la formation, promouvoir la distribution numérique et multiplier les programmes de résidence créative s’inscrivent dans une temporalité longue, celle d’un État qui perçoit dans la culture un vecteur stratégique de diversification. Brazzaville quitte la ferveur des spotlights avec la conviction que la prochaine édition trouvera un continent mieux préparé à transformer sa puissance créative en pleine valeur ajoutée, et un Congo plus que jamais prêt à tenir son rang.