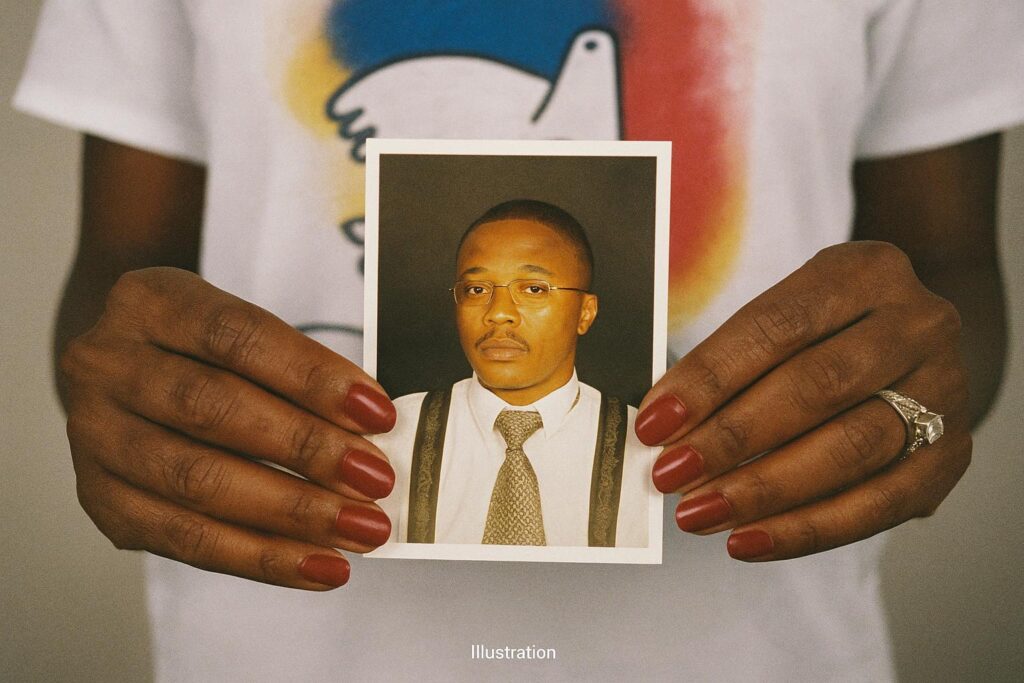Une trajectoire exemplaire écourtée à Goma
Le 6 juillet 2007, l’agglomération de Goma s’éveillait sur une macabre découverte : le corps de Floribert Bwana Chui Bin Kositi, 26 ans, abandonné près du campus de l’Université de Kisangani délocalisé dans le Nord-Kivu. Quelques heures plus tôt, le jeune fonctionnaire des douanes, fraîchement diplômé en droit, avait été enlevé par des inconnus. Sa courte carrière au poste frontière de la Grande Barrière ne comptait que trois mois, mais suffisait à révéler une rectitude morale peu commune dans une région où le commerce transfrontalier sert souvent de caisse de résonance aux conflits.
Fils d’un cadre bancaire et d’une policière des frontières, Kositi avait grandi dans un environnement relativement privilégié. Son parcours universitaire, marqué par l’excellence académique et la participation active à la Communauté de Sant’Egidio, le prédisposait à une lecture éthique de la vie publique. « Il s’interrogeait sans relâche sur les racines de la pauvreté et sur le rôle que pouvait jouer la jeunesse dans la transformation du pays », se souvient aujourd’hui le père Francesco Tedeschi, témoin clé de son engagement.
Le refus du pot-de-vin et la mécanique du crime organisé
Affecté en avril 2007 au contrôle des cargaisons entrant du Rwanda, le jeune douanier bloque, puis fait analyser, un lot de riz de quatre tonnes dont la date de péremption est manifestement falsifiée. L’expertise médicale sollicité auprès d’une religieuse médecin confirme la dangerosité du produit. Commence alors une escalade de pressions : selon la Communauté de Sant’Egidio, 1 000 dollars lui sont d’abord promis, puis le double, « et même davantage ». En dépit d’appels insistants venant, dit-on, « d’autorités publiques », Kositi reste inébranlable.
Dans un environnement où la fraude douanière alimente aussi bien les économies informelles que certains groupes armés, cette inflexibilité constitue une menace tangible pour les réseaux criminels. « L’assassinat devait servir d’exemple dissuasif », analyse un officier sécuritaire en poste à Bukavu sous couvert d’anonymat. Les méthodes employées – enlèvement, torture, exposition publique du cadavre – rappellent en effet les rituels punitifs d’une criminalité transnationale qui prospère sur la porosité des frontières des Grands Lacs.
De la mort violente à la reconnaissance ecclésiale
À l’échelle de l’Église catholique, la trajectoire de Kositi a pris une ampleur inattendue. Déclaré martyr en 2024, béatifié à Rome en juin 2025 sous la présidence du pape Léon XIV, il pourrait être canonisé dès qu’un miracle lui sera attribué. Cette célérité contraste avec les délais habituels de la Congrégation pour les causes des saints et illustre la portée universelle que le Vatican entend donner au témoignage d’un laïc africain face à la corruption.
Lors de son voyage apostolique à Kinshasa en 2023, le pape François avait déjà cité le nom de Kositi comme symbole d’une « jeunesse capable de dire non au bakchich et oui à l’avenir ». Dans les chancelleries occidentales, cet écho nourrit une réflexion nouvelle sur la diplomatie préventive : la promotion d’exemples éthiques locaux pourrait-elle compléter les programmes traditionnels d’assistance sécuritaire ?
Un signal pour la gouvernance dans les Grands Lacs
La mort de Kositi intervient dans un contexte où la RDC multiplie les initiatives d’assainissement de la chaîne logistique minière et agricole, sous la pression des partenaires commerciaux internationaux. Le gouvernement de Kinshasa a ainsi renforcé les contrôles phytosanitaires aux frontières et ratifié plusieurs accords régionaux sur la transparence des flux. Bien que tardif pour sauver le jeune fonctionnaire, ce cadre normatif dessine un horizon plus favorable à l’intégrité du service public.
D’un point de vue diplomatique, l’affaire interroge également la coopération entre Kinshasa et Kigali. La saisie d’un produit avarié illustre la nécessité d’un échange d’informations en temps réel entre autorités sanitaires des deux pays. L’Union africaine, appuyée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, explore la création d’un mécanisme conjoint de veille douanière qui, s’il voit le jour, fera figure d’héritage institutionnel du sacrifice de Kositi.
L’éthique individuelle, clef de voûte d’une réforme durable
Au-delà des dispositifs législatifs, le cas Kositi rappelle la dimension profondément personnelle de la lutte anticorruption. Plusieurs programmes de formation, inspirés par la mémoire du jeune martyr, sont désormais déployés dans les écoles de police et d’administration publique congolaises. Ils insistent sur la responsabilité individuelle, mettant en avant la cohérence entre convictions privées et obligations officielles.
Comme le souligne l’universitaire rwandais Bernard Musana Segatagara, ancien camarade de Kositi, « les textes ne protègent qu’à hauteur de l’intégrité de celles et ceux chargés de les appliquer ». Dans un espace régional confronté à la circulation des armes légères et à la concurrence pour les ressources, la vertu civique n’est pas une abstraction morale : elle constitue un facteur tangible de stabilité. La mémoire de Floribert Kositi, aujourd’hui honorée dans les paroisses et les amphithéâtres, offre un récit mobilisateur, apte à fédérer pouvoirs publics, société civile et partenaires extérieurs autour d’une exigence commune : replacer l’éthique au cœur de la gouvernance.